C'étaient juste des filles qui n'avaient pas eu de chance souvent, nées dans des familles pauvres, avec des pères alcooliques ; des filles vulnérables qui faisaient de mauvaises rencontres et se retrouvaient enceintes, qui volaient parce qu'elles avaient faim...
Et les voilà accusées de vagabondage, de prostitution ; traitées de voleuses, vicieuses, hystériques. Au 19ème siècle, époque de la « correction paternelle » toute puissante et du Code Civil imaginé par Napoléon, c'est facile de se débarrasser de celles qui gênent. On les enferme dans des couvents où elles resteront privées de liberté jusqu'à leur majorité, à 21 ans.
A Rennes, le couvent/prison s'appelait Saint-Cyr. Les Filles Penchées, la pièce de Cécile Cayrel revient sur cette histoire, sur ces histoires.

Sur scène, les mauvaises filles sont trois : Anne, Gisèle et Madeleine ; toutes trois condamnées à résider à Saint-Cyr jusqu'à leur majorité. La plus âgée est arrivée à seize ans, la plus jeune à douze. A elle trois, elles représentent les 52 000 filles retenues dans les couvents de France juste avant la deuxième guerre mondiale. Plusieurs en une et toutes en trois.
Cécile Cayrel, l'autrice de la pièce Les Filles Penchées, a construit ses personnages à partir de témoignages et d'archives consultées au cours de sa résidence au théâtre de la Paillette, situé à Rennes sur le terrain autrefois occupé par le couvent. Elle parle essentiellement de la vie derrière les hauts murs encore visibles aujourd'hui rue Louis Guilloux. Elle parle aussi de toutes les autres, retenues dans d'autres lieux où 10 000 religieuses, sans formation et sans subvention, avaient été chargées d'assurer leur « redressement ».
« Les protéger de la rue, de l'errance
et des risques pernicieux de celle-ci,
la concupiscence, la prostitution »
« Ces couvents étaient utiles pour comprimer le corps social des filles » décrit Cécile Cayrel. Pour ses recherches avant l'écriture, elle a rencontré quelques vieilles sœurs aujourd'hui accueillies à l'EHPAD Saint-Cyr et a pu consulter les archives déposées à Caen dans un autre couvent encore en activité. C'est là que l'écriture de son texte a vraiment commencé, dit-elle, parce que « tout y est ». Les mots, les expressions, tous ces jugements sur les filles qu'elle reprend dans sa pièce.
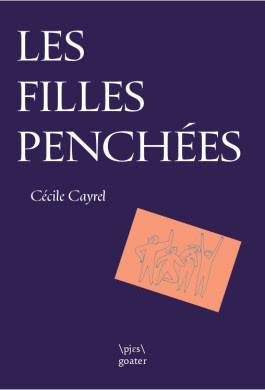 « Je les ai condensés pour raconter plusieurs histoires en une seule – raconte-t-elle – mais énormément de mots que j'utilise viennent directement des archives », de ces petits carnets où les religieuses consignaient leurs remarques sur les comportements de leurs pensionnaires, tout sauf du vocabulaire professionnel. Elles sont décrites comme sales, peu intelligentes, paresseuses, de nature perverse..
« Je les ai condensés pour raconter plusieurs histoires en une seule – raconte-t-elle – mais énormément de mots que j'utilise viennent directement des archives », de ces petits carnets où les religieuses consignaient leurs remarques sur les comportements de leurs pensionnaires, tout sauf du vocabulaire professionnel. Elles sont décrites comme sales, peu intelligentes, paresseuses, de nature perverse..
Matériellement, il n'y a pas – ou rarement – de délits ; d'ailleurs lors des procès les accusées sont généralement acquittées mais condamnées tout de même au redressement chez les religieuses. Non pas pour les punir, leur explique-t-on doctement, mais pour les « protéger de la rue, de l'errance et des risques pernicieux de celle-ci, la concupiscence, la prostitution ». Les protéger des autres mais surtout d'elles-mêmes.
Les femmes, faut-il le rappeler ne sont pas considérées comme des citoyennes à part entière par le Code Civil de Napoléon dans lequel on peut lire : « les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux ». Ce qui fait écrire à Cécile Cayrel : « on ne savait pas où vous mettre, il restait une place entre les enfants et les tueurs d'enfants, on s'est dit c'est mieux que rien ! »
« Le travail est, après la piété,
le second moyen de redressement moral »
Pour ces « filles déviantes » point d'éducation mais de la rééducation par le travail. Même les plus jeunes s'épuisent en lessives et raccommodages : draps et uniformes militaires, linge des grands hôtels ou des bourgeois de la ville mais aussi confection pour la Samaritaine ou le Bon Marché. « Le travail est, après la piété, le second moyen de redressement moral » affirme dans la pièce le personnage de Sœur Marie-Emmanuelle.
 Les histoires de ces filles, estime Cécile Cayrel, « nous montrent que le vent peut tourner rapidement ». Si des femmes avaient du pouvoir par le passé, et notamment au Moyen-Age, le Code Napoléon de 1804 les a vite fait renvoyées dans leur cuisine. Grâce à lui, les pères peuvent demander et obtenir facilement l'enfermement de leurs filles au couvent, comme des maris obtiendront celui de leurs épouses dans les asiles psychiatriques.
Les histoires de ces filles, estime Cécile Cayrel, « nous montrent que le vent peut tourner rapidement ». Si des femmes avaient du pouvoir par le passé, et notamment au Moyen-Age, le Code Napoléon de 1804 les a vite fait renvoyées dans leur cuisine. Grâce à lui, les pères peuvent demander et obtenir facilement l'enfermement de leurs filles au couvent, comme des maris obtiendront celui de leurs épouses dans les asiles psychiatriques.
Un message sur lequel l'autrice insiste. En ce moment, le vent tourne et le backlash menace de plus en plus toutes les femmes. Sa pièce, Cécile Cayrel l'a écrite pour qu'elle soit jouée devant des publics adolescents. Parce que dit-elle, elle voulait « qu'ils et elles se questionnent sur le droit des femmes aujourd'hui ». Ce qui peut paraître une époque révolue trouve encore des échos dans notre société. « Aujourd'hui – dit-elle – on n'enferme plus les filles mais il y a toujours un carcan social hyper présent ». Si les causes et les conséquences ont changé, les mécanismes en place sont bien les mêmes.
« Est-ce qu'on envoie les garçons chez les moines ? » s'interroge une des personnages de la pièce. Bien sûr que non, lui répond-on. Parce que « les garçons, c'est pas pareil. (…) On est un mauvais garçon parce qu'on FAIT quelque chose. On est une mauvaise fille parce qu'on EST quelque chose ! »
Geneviève ROY
Pour aller plus loin : le texte de Les Filles Penchées de Cécile Cayrel est édité aux éditions Goater
Photos :
1 – Cécile Cayrel (à droite) autrice de la pièce Les Filles Penchées à l'issue de la représentation du 12 mars 2025 à la Bibliothèque Universitaire de Beaulieu
3 – Trois des quatre comédien.ne.s de la compagnie Les Odyssées lors de la lecture théâtralisée du 12 mars à la Bibliothèque Universitaire de Beaulieu




