 « Simone Veil a dit : aucune femme n'avorte jamais de gaieté de cœur ; l'avortement est un drame et sera toujours un drame ! Et bien moi, je dis : c'est pas vrai ! Il y a des femmes pour qui c'est un drame et des femmes pour qui c'est juste un soulagement ; je peux en témoigner ».
« Simone Veil a dit : aucune femme n'avorte jamais de gaieté de cœur ; l'avortement est un drame et sera toujours un drame ! Et bien moi, je dis : c'est pas vrai ! Il y a des femmes pour qui c'est un drame et des femmes pour qui c'est juste un soulagement ; je peux en témoigner ».
Et justement Annie Chemla en a témoigné dans un livre intitulé avec vigueur : Nous l'avons fait. Pour cette ancienne militante du MLAC des années 70, il était important de « transmettre une mémoire oubliée » de ces combats que menèrent nombre d'anonymes avant la légalisation de l'IVG.
Une pratique devenue banale qui pourtant, aujourd'hui encore, cinquante ans plus tard, n'est toujours pas considérée comme les autres.
« Pourquoi est-on à ce point imprégné.e.s de l'idée qu'un avortement est un échec, un drame dont on ne doit pas parler ? » s'interroge Annie Chemla qui dit encore « on se raconte nos accouchements, jamais nos avortements ».
Parmi tout ce qu'elle a retenu de ses années de militantisme au MLAC (mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception) de 1973 à 1980, c'est un sentiment de fierté qui domine aujourd'hui. Et l'importance du collectif. Ce n'est pas un hasard si son livre s'intitule « nous l'avons fait ».
Pour elle, cette lutte s'est toujours conjuguée au pluriel et si elle a écrit son livre seule, ce qu'elle continue à regretter un peu, c'est faute d'avoir pu entraîner à ses côtés ses anciennes copines. Mais, convaincue qu'il fallait insister sur l'aspect collectif du mouvement, elle a d'abord collecté de nombreux témoignages qui ont enrichi ses souvenirs personnels voire parfois leur ont permis de remonter à la surface.
« Maintenant, on appelle ça la sororité ;
à l'époque je n'avais pas de mots »
Annie Chemla avait vingt-six ans en 1973 lorsqu'elle a rejoint un groupe de parole du MLF. « On était une douzaine, assises en rond, par terre et j'ai réalisé à quel point, toutes, on se ressemblait. Ça m'a fait un bien fou et ça a fait tomber mes angoisses définitivement - se souvient-elle aujourd'hui encore frissonnante - Maintenant, on appelle ça la sororité ; à l'époque je n'avais pas de mots ».
Une découverte qui allait la guider toute sa vie. Très vite, elle rejoint un groupe du MLAC dans son quartier parisien et devient active. « J'étais celle qui accueillait les femmes, qui restait à leurs côtés, leur tenait la main, les aidait à respirer » décrit celle qui finalement ne pratiquera les gestes plus techniques de l'avortement qu'après l'adoption de la loi.
Car si la loi votée au Parlement en 1974 et appliquée à partir de 1975 semble une victoire, pour les militant.e.s du MLAC le chemin n'est pas fini. « C'était une loi très peu satisfaisante qui heureusement a été corrigée depuis – analyse Annie Chemla – l'IVG coûtait très cher (la moitié d'un SMIC) et n'était pas remboursée, était interdite aux mineures sans autorisation des parents et interdite aux femmes étrangères, c'était une loi provisoire votée pour cinq ans à titre expérimental et on n'avait pas le droit d'en parler ».
 Pour contourner tous ces obstacles auxquels s'ajoutait le fait que les médecins n'étaient pas formés et rarement volontaires et que les hôpitaux n'étaient pas équipés, les bénévoles du MLAC sont resté.e.s actif.ve.s pendant encore quelque temps.
Pour contourner tous ces obstacles auxquels s'ajoutait le fait que les médecins n'étaient pas formés et rarement volontaires et que les hôpitaux n'étaient pas équipés, les bénévoles du MLAC sont resté.e.s actif.ve.s pendant encore quelque temps.
« Mon corps, mon choix, mes droits
est un slogan qui n'a pas pris une ride ! »
« C'est incroyable la force que ça nous a donné ; on s'est senties puissantes - répète Annie Chemla, toujours enthousiaste à l'idée de partager ce qu'elle a vécu dans ces années très spéciales - On était insatiables de savoirs, on s'est emparées de dizaine de choses ensemble. On a fait de la cuisine, de l'accordéon, de l'acrobatie, on a appris à réparer nos mobylettes, c'était une dynamique formidable ».
Et quand des femmes leur confiait leur corps, la seule chose qui les effrayait n'était pas de se faire arrêter par la police, mais juste « de mal faire et de leur faire mal ». Annie Chemla se demande si finalement ces moments n'auraient pas « pris plus de place dans [leurs] vies que dans celles des femmes [qu'elles] aidaient » qui elles, repartaient « joyeusement », soulagées d'un poids qui obscurcissait leur avenir.
Aujourd'hui, parce qu'on célèbre les cinquante ans de la loi Veil, parce que le droit à l'IVG a été inscrit dans la Constitution voilà un an, parce qu'elle a publié son livre, l'ancienne militante a souvent l'opportunité de rencontrer des jeunes femmes désormais engagées sur les chemins du féminisme. Elle se réjouit de leur énergie.
« Notre combat pour dire mon corps m'appartient c'est le même que celui qui lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le même que celui qui met en avant les violences obstétricales, c'est le même que celui sur la transidentité – déclare-t-elle – mon corps, mon choix, mes droits est un slogan qui n'a pas pris une ride ! »
« Faire croire que c'est gravé dans le marbre
et qu'on ne reviendra pas en arrière,
c'est faux et c'est dangereux ! »
Hélas, toutes ces rencontres lui donnent aussi l'occasion de constater « l'état assez déplorable de l'avortement en France ». « Près de 80% des femmes avortent sous médicaments, une femme sur sept doit changer de département pour avorter et beaucoup se retrouvent hors délais – déplore-t-elle – parce qu'il n'y a plus de médecins pour pratiquer l'avortement instrumental. »
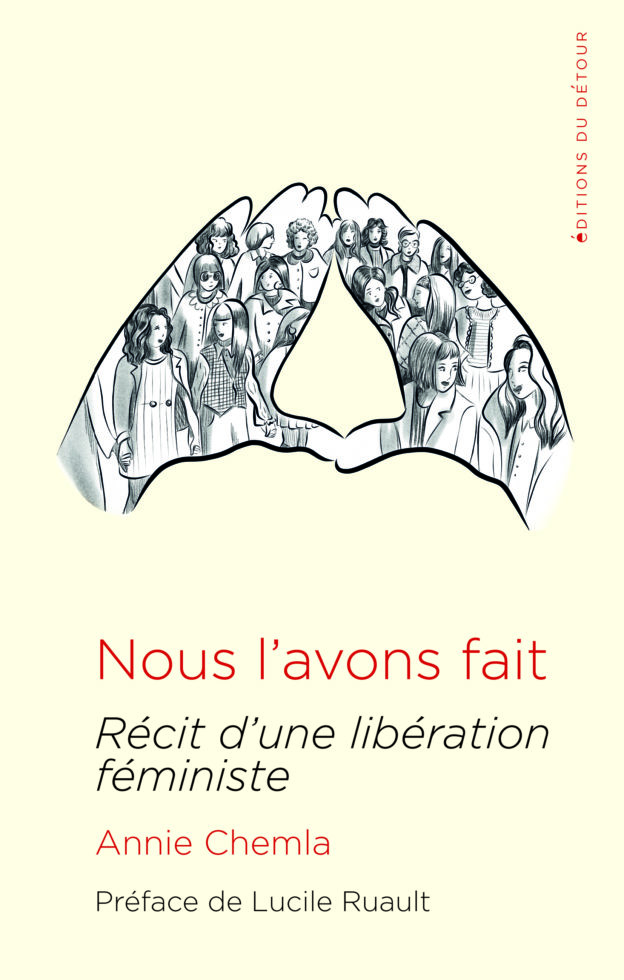 Désormais, tous les praticiens qui avaient mis en œuvre l'application de la loi sont en retraite et leur succession n'a pas été assurée. Alors que 240 000 avortements sont pratiqués chaque année en France et qu'une femme sur quatre sera concernée au cours de sa vie procréative, l'IVG qui devrait être « d'une grande banalité » reste un acte à part, un acte pour lequel les femmes ne sont souvent ni assez informées ni assez accompagnées.
Désormais, tous les praticiens qui avaient mis en œuvre l'application de la loi sont en retraite et leur succession n'a pas été assurée. Alors que 240 000 avortements sont pratiqués chaque année en France et qu'une femme sur quatre sera concernée au cours de sa vie procréative, l'IVG qui devrait être « d'une grande banalité » reste un acte à part, un acte pour lequel les femmes ne sont souvent ni assez informées ni assez accompagnées.
Pour Annie Chemla ce peu d'appétence des médecins s'explique par une faible rémunération associée à l'IVG, une absence de valorisation mais aussi pense-t-elle, le fait que la décision revient non pas aux soignants mais aux patientes. Les sages-femmes qui ont désormais l'autorisation de pratiquer des IVG ont semble-t-il du mal à obtenir les conventionnements nécessaires. C'est pourtant sur elles que repose l'espoir de voir cette situation débloquée en France.
Attention, dit encore Annie Chemla, un droit n'est jamais complètement acquis. On le voit de plus en plus dans l'actualité mondiale, il est important de rester vigilant.e.s. Et ce n'est pas pour elle la constitutionnalisation au droit à l'IVG qui garantira son accès définitivement. « Les droits en général et les droits des femmes en particulier – prévient-elle – sont toujours des conquêtes et si on ne les défend pas, ils régressent. Faire croire que c'est gravé dans le marbre et qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est faux et c'est dangereux ! »
Geneviève ROY
Annie Chemla était le 20 mars l'invitée de Femmes en Chemin, rencontre organisée par Breizh Femmes, en partenariat avec Rennes Métropole et la librairie L'Etabli des Mots.
Pour aller plus loin : « Nous l'avons fait – récit d'une libération féministe » de Annie Chemla aux éditions du Détour




